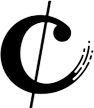Dans le travail pour ensemble éléctrifié Five Songs (Kafka’s sirens) écrite pour l’Ensemble C Barré, le titre fait allusion – mais il ne s’agit pas d’une réference litterale – au récit de Franz Kafka Le silence des sirènes. En réalité le récit de Kafka ne veut pas tellement raconter une histoire alternative (qui dirait que les sirènes ne chantèrent pas) mais plutôt suggérer un paradoxe, insinuer un doute de perspective.
C’est plutôt à cela – à une possible perspective paradoxale – que le titre fait allusion. Il s’agit d’une forme articulée en cinq « chansons » instrumentales où la question poétique qui me s’était imposée était la suivante : qu’est-ce qu’il reste du chant quand la voix disparaît ?
Qu’est-ce que ça peut être l’essence du chant et comment peut-on percevoir le chant quand personne ne chante ? Cette présence du chant dans l’absence d’une voix qui chante était le moteur de la recherche sonore instrumentale, une sorte d’aporie que – tel que le paradoxe de Kafka – visait à repousser les limites du « visible » instrumental.
Cette première question appelle naturellement une question qui est en quelque sorte l’inverse : qu’est-ce que la voix sans le chant ? La voix pour sa pure présence, dépourvue de sa fonction orphique ? La voix comme corps instrumental, et comme corps tout court, la voix comme présence charnelle qui précède et dépasse la parole. Une sorte d’objet apotropaique dont on saurait sans le comprendre.
L’exploration de cette autre moitié de la question, a pousser à intégrer l’ensemble vocal Neue Vocalsolisten avec qui l’Ensemble C Barré est musicalement complice depuis quelques années, dans ce voyage musical, qui se déroule donc entre ces deux extrêmes. L’extrême absence et l’extrême présence, le chant dans la voix et la voix sans le chant. Entre ces deux point focaux du paradoxe se situe peut-être ce qui attire tant Ulysse à s’approcher de sirènes.
Ce voyage est structuré en plusieurs moments qui explorent différents aspects de la voix en tant que corps, de la voix en tant que corps instrumental, de la voix en tant que chant, et de la voix qui, en incarnant la parole, la transforme, l’annulle et la dépasse, pour former une œuvre totale d’une durée de 1h15 environ. Tout cela est transparent, car tous ces aspects sont des dimensions voisines propres à l’expérience musicale. En guise juste de guide d’écoute, nous dirons seulement que les points abordés dans ce voyage sont les suivants :
– Five songs (Kafka’s sirens), cinq chansons sans voix
– Voices. (15 min env) Où la voix est présente comme un corps, avant d’être chant et avant d’être parole. Un corps qui s’enfouit dans le corps du son pour le transformer et le reécrire. On se trouve ici avant le texte. Il y a un’expérience perceptive du son vocal dont la vocalité serait oubliée : l’experience de sa corporéité à travers son occupation et sa transformation sciamanique du son musical.
– Unvoiced. (6 min env) Ce que l’on appelle « unvoiced » ce sont les consonnes aphones, qui n’ont pas besoin des vibrations des cordes vocales pour produire le son. Cette partie bruitée de l’émission vocale permet l’articulation, et l’articulation est du temps articulé. Cette partie se déroule dans un état musical de « temps pur » où la voix habite et est elle-même prisonnière d’une écriture purement temporelle.
– A valediction for her sister (a love song). (6 min env) Ce moment est une chanson au sens propre du terme. Il s’agit d’une chanson d’amour pour voix et guitare acoustique uniquement. La guitare a une scordatura particulière qui la rapproche du luth, et l’espace harmonique vocal est un espace microtonal non-temperé (juste). Le texte utilisé ici est une ancienne chanson en griko (langue née de l’hybridation du grec ancien avec les langues autochtones du Salento), recueillie à Corigliano. Le texte folklorique anonyme se trouve encore dans un « lieu » poétique qui précède celui du moi poétique et où les intentions intellectuelles et intellectualisantes sont encore absentes. Il s’agit de la vie qui, en se déployant, chante et danse la naissance, l’amour et la mort, trouvant – pour ainsi dire – les mots dans la rue (de toutes chansons populaires il y a toujours plusieurs versions). C’est finalement une poésie qui ne s’est pas encore séparée des corps. Voici le texte en griko et en italien :
Aspron e’ to chartì, aspro e’ to chioni,
aspron e’ to chaladzi, aspri ine i krini,
aspro to sfondilòssu ce i vrachoni,
c’echi is o’ petto dio mila afse asimi.
Isèa se kaman dio mastoroni
ce se pingéfsane i aji serafini;
ce se pingefsan ce se kaman òria,
pu ’e s’echi de’ is in ghì manku is in gloria.
Bianca è la carta ed è bianca la neve,
bianca è la grandine e son bianchi i gigli,
bianco il tuo collo e bianche le tue braccia,
poggiate al petto due mele d’argento.
Ti hanno pensata due grandi pittori,
ti hanno dipinta due santi serafini;
ti hanno dipinta e ti hanno fatta bella,
e non c’è uguale in cielo e sulla terra.
– Vocali. (3 min env) Ici, le spectre des instruments est associé au spectre formé par la modification de la cavité buccale par la production de sons vocaux (voyelles), qui permet d’accéder aux différents partiels.
– Bodiless. (2 min env) Ici, la voix est confrontée à un double électronique qui remet en question sa présence physique et l’espace « naturel » de son rayonnement sonore.
– Andemironnai (a song of migration). (15 min env) Andemironnai ou Iandemironnai est un refrain qui forme les strophes d’une chanson traditionnelle sarde, dont les paroles sont les suivantes : « Iandemironnai andire nora ndira iandemironnai ».
« Beaucoup font remonter la chanson (dont les paroles sont aujourd’hui incompréhensibles) à des temps très anciens, peut-être à l’époque de la mythique et très archaïque Nora, une ville pré-nuragique aujourd’hui submergée. L’obscur refrain, avec son terme qui évoque vaguement le « va et vient » et sa voix « nora » qui est certainement d’époque protosarde, a tout l’air d’être très ancien. Il se peut (si l’on écoute son imagination) que le refrain utilise le mot Nora pour exprimer le regret d’une patrie perdue : la ville de Nora, ancienne escale phénicienne (NDLR : Carta Raspi la fait remonter au Shardana, mais elle pourrait être beaucoup plus ancienne), puis centre punique et plus tard ville romaine florissante qui a conservé jusqu’à la fin l’orgueil d’être la ville mère de toutes les autres villes sardes. À l’époque romaine, il avait un rang d’honneur égal à celui de Kàralis. Ses vestiges (temples, nécropoles, quais, bâtiments portuaires romains, basiliques, etc.) ont été dévastés par l’action des séismes et de la mer. Détruite par les invasions vandales, Nora n’a jamais pu renaître. Ce sont donc des mots dont le sens verbal est perdu, mais qui ont néanmoins une autre signification dans la chanson qui l’incarne encore aujourd’hui. »(1)
C’est une polyphonie aux structures polyrythmiques et microtonales où l’écriture instrumentale s’épaissit jusqu’à la saturation de l’espace. On explore le concept de limite et d’illusion temporelle. Le mouvement est inevitable et inevitablement pousse vers l’inconnu. On revient alors aux sirènes comme image de la limite du chant et du son même (les sirènes de Kafka devaient leur horreur à leur silence qui aurait pu rompre les résistences même d’Ulisses). En effet, « le mythe des sirènes a également servi, entre autres fonctions, à permettre un discours sur l’espace, et en particulier sur les notions de limite, de frontière et de marge. Ces catégories sont à la fois analogues et différentes dans leurs diverses significations : la limite est l’endroit où quelque chose finit, mais aussi où quelque chose commence, ce qui rend la réalité mesurable et donc porteuse de sens ; la frontière, en revanche, présuppose une division, mais aussi une relation entre le même et le différent, entre le soi et l’étranger. Et c’est précisément là qu’intervient la catégorie de la marge, qui définit ce qui n’est ni de ce côté ni de l’autre de la frontière, le no man’s land, le lieu de passage, de transformation. »(2)
… to be continued
(1) https://horoene.wordpress.com/2017/03/27/un-antico-canto-perduto-sandimironnai/
(2) Mancini L. (2010) « Le Sirene come paradigma del margine nella cultura greca arcaica »